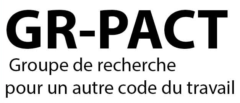§ 1 : Bénéficiaires
L. 75-1.
En complément des mesures d’accompagnement, les personnes involontairement privées d’emploi et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées ci-après.
Les personnes ayant conclu une rupture consentie avec leur employeur sont assimilées à des personnes involontairement privées d’emploi.
Une condition de durée d’activité antérieure est prévue par les conventions relatives à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 75-32.
L. 75-2.
Le revenu de remplacement prend, selon les cas, la forme :
– d’une allocation d’assurance chômage, prévue aux articles L. 75-7 ;
– d’allocations et d’indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au paragraphe 5 de la présente section.
L. 75-3.
La recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement s’effectue dans le cadre déterminé par le programme de recherche d’emploi.
L. 75-4.
Les cas dans lesquels l’allocataire est dispensé de recherche d’emploi sont définis par décret en Conseil d’Etat.
L. 75-5.
Le revenu de remplacement cesse d’être versé aux allocataires réunissant les conditions pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein selon les modalités définies par décret.
L. 75-6.
Les périodes d’activité professionnelle non déclarées à Pôle emploi du fait d’une information insuffisante ou erronée de Pôle emploi, d’une erreur matérielle dans la déclaration ou d’un non-paiement par l’employeur, ainsi que les périodes d’activité professionnelle déclarées n’ayant pas fait l’objet d’une attestation par l’employeur, sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation d’assurance.
Les rémunérations correspondantes sont incluses dans le salaire de référence.
§ 2 : Allocation d’assurance chômage
a) Modalités
L. 75-7.
L’allocation d’assurance chômage est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L. 75-8.
Le temps consacré, avec l’accord de Pôle emploi, à des actions de formation rémunérées est compris partiellement ou totalement dans la durée de versement de l’allocation d’assurance chômage.
L. 75-9.
Les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les conditions définies dans les conventions relatives à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 75-32.
L. 75-10.
L’allocation d’assurance est calculée en fonction de la rémunération ayant donné lieu à cotisation.
Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
L. 75-11.
Le report de la date de la rupture du contrat de travail par le juge ainsi que la condamnation de l’employeur au versement de dommages-intérêts sont sans effet sur le début du versement de l’allocation consécutif à la déclaration de recherche d’emploi.
L. 75-12.
La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de Pôle emploi par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa déclaration comme demandeur d’emploi.
L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi.
L. 75-13.
Lorsque, du fait des modalités particulières d’exercice d’une profession, les conditions d’activité antérieure pour l’admission à l’allocation d’assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d’activité ainsi qu’à la durée d’indemnisation et aux taux de l’allocation dans des conditions fixées selon le cas par la convention prévue à l’article L. 75-32 ou par décret en Conseil d’Etat.
L. 75-14.
Les travailleurs privés d’emploi bénéficient de l’allocation d’assurance, indépendamment du respect par l’employeur des obligations qui pèsent sur lui en application des articles 75-62 et suivants, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution.
L. 75-15.
Le bénéfice de l’allocation d’assurance peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers privés d’emploi qui quittent la France pour s’installer dans leur pays d’origine.
L. 75-16.
Les allocations peuvent être cumulées avec des revenus d’une activité professionnelle reprise ou réduite ainsi qu’avec les prestations de sécurité sociale et d’aide sociale dans des conditions fixées par la convention mentionnée à l’article L. 75-32, dans la limite du salaire perçu avant la déclaration de recherche d’emploi.
b) Trop-perçus
L. 75-17.
Tout paiement indu par Pôle emploi est remboursé par l’allocataire, dans les conditions fixées ci-après.
L. 75-18.
Si l’allocataire ne conteste pas le caractère indu de ce paiement, le remboursement peut être réalisé par des retenues sur les prestations à venir.
Le montant des retenues ne peut dépasser les proportions et les seuils relatifs à la saisie des rémunérations prévus aux articles L. 53-23
L. 75-19.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, l’allocataire peut toutefois opter pour un remboursement intégral de la dette en un seul versement.
Le plafond mentionné à l’article précédent est alors inapplicable.
L. 75-20.
Lorsque Pôle emploi envisage le remboursement d’une prestation versée par lui et indûment perçue par un allocataire, il en informe ce dernier en lui indiquant :
1° la prestation concernée ;
2° les déclarations et les documents examinés ;
3° le motif, le mode de calcul et le montant des sommes réclamées ;
4° la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
5° la faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à Pôle emploi dans un délai de trente jours ;
6° le droit pour Pôle emploi de procéder par retenues sur les échéances à venir, ainsi que les modalités et montants de ces retenues, en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai ;
7° la faculté ouverte au demandeur d’emploi d’opter pour un remboursement intégral en un seul versement.
L. 75-21.
Dans sa réponse, l’allocataire peut indiquer toute précision ou tout complément qu’il juge nécessaire, notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque l’allocataire fait part de ses observations dans le délai prévu au 5° de l’article précédent, Pôle emploi est tenu de répondre et d’indiquer s’il maintient ou non sa décision ordonnant le remboursement des sommes indûment perçues.
Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par l’allocataire fait l’objet d’une réponse motivée.
L. 75-22.
La décision ordonnant le remboursement de prestations indûment perçues par un allocataire est notifiée et motivée.
L. 75-23.
Cette décision est adressée à l’allocataire :
– soit à l’issue du délai fixé au 5° de l’article L. 75-20 en l’absence de réponse de l’allocataire parvenue dans ce délai à Pôle emploi ;
– soit après l’envoi par Pôle emploi du courrier par lequel il a été répondu aux observations de l’allocataire.
L. 75-24.
Cette décision indique :
– la prestation concernée ;
– les déclarations et les documents examinés ;
– le motif, le mode de calcul et le montant du trop-perçu ;
– la période correspondant au trop-perçu ;
– les modalités et l’échelonnement du remboursement ;
– les voies et délais de recours ouverts à l’allocataire.
L. 75-25.
Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de dette ainsi que les recours préalables et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
L. 75-26.
L’allocataire qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours préalable devant la commission de recours amiable mentionnée à l’article L. 74-27.
L. 75-27.
La commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l’allocataire entend former un recours.
La forclusion ne peut être opposée à l’allocataire que si cette notification porte mention de ce délai.
L. 75-28.
Toute demande de remboursement de trop-perçu ordonnée par Pôle emploi est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des prestations dans les mains du bénéficiaire et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par un délai de cinq ans.
L. 75-29.
En cas d’erreur de Pôle emploi, aucun remboursement de trop-perçu des prestations n’est réclamé à un allocataire de bonne foi, lorsque ses ressources sont inférieures ou égales au montant fixé pour l’attribution du revenu de solidarité active.
L. 75-30.
L’allocataire débiteur d’un trop-perçu peut solliciter une remise de dette auprès de la commission de recours amiable mentionnée à l’article L. 74-27.
L. 75-31.
Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation qu’il a indûment versées.
c) Conventions collectives relatives à l’assurance chômage
L. 75-32.
Les mesures d’application des dispositions de la présente section, à l’exception des dispositions relatives au trop perçu prévues aux articles L. 75-17 à L. 75-31 et ce celles concernant le suivi parlementaire et gouvernemental, prévue à l’article L. 75-37, font l’objet de conventions collectives nationales et interprofessionnelles, conclues suivants les règles prévues aux articles L. 33-1 et suivants.
Ces conventions collectives sont agréées dans les conditions définies par les articles L. 75-34 et L. 75-35.
L. 75-33.
En l’absence de conventions collectives d’application ou en l’absence d’agrément de celles-ci, des mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L. 75-34.
L’agrément rend obligatoires les dispositions de la convention pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cette convention.
L’agrément est délivré pour la durée de la validité de la convention.
L. 75-35.
Pour pouvoir être agréées, les conventions collectives d’application ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l’emploi, à la compensation des offres et des demandes d’emploi, au contrôle des travailleurs privés d’emploi, et à l’organisation du placement de l’orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
L. 75-36.
Les cotisations des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 75-68 et suivants financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l’article L. 75-32 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section » Fonctionnement et investissement » et à la section » Intervention » du budget de Pôle emploi, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d’administration de cette institution.
d) Suivi parlementaire et gouvernemental
L. 75-37.
L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 74-39 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage.
Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme.
§ 3 : Contrôle et sanction du demandeur d’emploi
L. 75-38.
Le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de Pôle emploi.
L. 75-39.
En cas d’abstention grave et répétée d’actes de recherche d’emploi compatibles avec le programme mentionné à l’article L. 74-51, une sanction allant de l’avertissement jusqu’à la réduction de l’allocation d’assurance peut être ordonnée par Pôle emploi.
L. 75-40.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, le revenu de remplacement peut être supprimé de manière temporaire ou définitive.
L. 75-41.
Les sanctions sont proportionnées à la gravité du manquement.
L. 75-42.
Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
L. 75-43.
La réduction et la suppression du revenu de remplacement sont prononcées dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
La réduction du revenu de remplacement ne peut excéder les plafonds prévus en matière de saisie sur salaire, mentionnés à l’article L. 53-23.
L. 75-44.
La sanction est prise par le directeur régional de Pôle emploi, sur proposition du responsable de l’agence locale de Pôle emploi.
L. 75-45.
Sauf si la sanction qu’il envisage est un avertissement, le directeur régional de Pôle emploi saisit avant toute décision la commission tripartite mentionnée à l’article L. 74-28.
L. 75-46.
Cette commission organise une audition du demandeur d’emploi avant de rendre son avis.
L. 75-47.
Au cours de l’audition, le demandeur d’emploi peut se faire assister par la personne de son choix.
L. 75-48.
La convocation à l’audition est effectuée par la commission après qu’elle ait reçu le dossier complet.
L. 75-49.
Cette convocation a lieu par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre indique l’objet de la convocation, la nature et les motifs de la sanction envisagée.
Elle mentionne la possibilité, pour le demandeur d’emploi, de se faire assister de la personne de son choix.
Elle mentionne le droit d’accès du demandeur d’emploi et de son assistant aux documents que Pôle emploi entend invoquer au soutien de la mesure qu’il envisage.
L. 75-50.
Au cours de l’audition, la commission rappelle et précise les motifs de la sanction envisagée.
Elle recueille les défenses et explications du demandeur d’emploi et celles de la personne venue l’assister.
L. 75-51.
La commission étudie les mesures alternatives à la sanction.
L. 75-52.
La commission ne peut rendre son avis moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’audition.
L. 75-53.
L’avis est motivé et notifié à l’intéressé et au directeur régional de Pôle emploi.
L. 75-54.
Le directeur régional de Pôle emploi ne peut sanctionner le demandeur d’emploi moins de deux jours ouvrables, ni plus de deux semaines après la réception de l’avis.
Il notifie sa décision au demandeur d’emploi.
Si celle-ci est différente de celle préconisée par la commission tripartite, la lettre explicite les motifs qui l’ont conduit à s’écarter de l’avis.
L. 75-55.
Le délai de prescription d’un manquement est de deux mois.
Si dans ce délai, le ministère public poursuit pénalement les faits, le délai est interrompu.
Le délai court à compter de la date à laquelle le manquement a été commis ou, si Pôle emploi prouve qu’il en a eu connaissance à une date précise ultérieure, à compter de cette date.
L. 75-56.
Lorsque Pôle emploi sanctionne un manquement non prescrit, il peut invoquer des faits antérieurs de même nature ou une sanction antérieure, pour justifier un accroissement de la sanction.
Cependant, il ne peut le faire que si le fait ou la sanction invoquée ont eu lieu moins de deux ans avant la saisine de la commission tripartite.
L. 75-57.
En cas de litige, le tribunal social apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au demandeur d’emploi sont de nature à justifier une sanction.
Pôle emploi fournit au tribunal social les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le demandeur d’emploi à l’appui de ses allégations, le tribunal social forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au demandeur d’emploi.
L. 75-58.
Le tribunal social annule une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée au manquement commis.
§ 4 : Financement de l’assurance chômage
L. 75-59.
Un fonds d’assurance chômage est constitué par convention nationale interprofessionnelle agréée.
L. 75-60.
Ce fonds est géré par un organisme créé par les parties à la convention interprofessionnelle agréée.
L. 75-61.
En l’absence de convention, la constitution du fonds d’assurance chômage est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L. 75-62.
Tout employeur, de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’Etat et des collectivités territoriales, est tenu d’assurer ses salariés contre le risque de perte d’emploi.
L’adhésion au régime d’assurance chômage ne peut pas être refusée.
L. 75-63.
L’Etat et les collectivités territoriales sont tenus de verser les prestations du fonds d’assurance chômage à leurs anciens salariés remplissant les conditions de bénéfice.
L. 75-64.
Les collectivités territoriales peuvent adhérer au régime d’assurance constitué par la convention nationale interprofessionnelle agréée.
L. 75-65.
L’employeur non adhérent au régime d’assurance chômage se voit imputer la charge de l’allocation versée à son ancien salarié en proportion des droits acquis par ce dernier.
L. 75-66.
Les employeurs soumis à l’obligation d’assurance déclarent les rémunérations servant au calcul des cotisations incombant tant aux employeurs qu’aux salariés.
L. 75-67.
Ces cotisations sont dues à compter de la date d’embauche de chaque salarié.
L. 75-68.
L’allocation d’assurance est financée par les cotisations des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes retenues pour le financement de l’assurance vieillesse, dans la limite d’un plafond.
L. 75-69.
Les cotisations des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.
Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les cotisations payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
L. 75-70.
Les taux des cotisations et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Les conventions prévues à l’article L. 75-32 peuvent majorer ou minorer les taux des cotisations en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise.
L. 75-71.
Les cotisations des employeurs et des salariés sont recouvrées et contrôlées par les organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ces régimes.
L. 75-72.
Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 74-39 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, le suivi de la politique de recouvrement, ainsi que les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
L. 75-73.
L’employeur qui a indûment retenu les cotisations précomptées sur le salaire est sanctionné par une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 15 000 euros.
L. 75-74.
En cas de récidive dans un délai de trois ans, l’employeur est sanctionné par une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 euros.