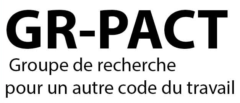§ 1 : Procédure
L. 26-1.
La procédure préalable au licenciement est menée par l’employeur de manière loyale.
a) Entretien préalable
L. 26-2.
L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
L. 26-3.
Lors de l’entretien, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Le temps consacré par l’assistant membre du personnel à la préparation et au déroulement de l’entretien est rémunéré comme du temps de travail.
L. 26-4.
La convocation à l’entretien est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Elle indique l’objet de la convocation et les motifs de la décision envisagée.
Elle mentionne la possibilité, pour le salarié, de se faire assister lors de l’entretien par un membre du personnel ou par un conseiller du salarié.
Elle précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Elle mentionne le droit d’accès du salarié et de celui qui l’assiste aux documents que l’employeur entend invoquer au soutien de la mesure qu’il envisage.
L. 26-5.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L. 26-6.
Au cours de l’entretien préalable, l’employeur rappelle et précise les motifs de la décision envisagée.
Il recueille les explications et la défense du salarié et de la personne qui l’assiste.
Il envisage les mesures alternatives au licenciement.
L. 26-7.
Au cours de l’entretien, lorsque le motif envisagé est économique, l’employeur et le salarié envisagent la possibilité de faire bénéficier ce dernier d’un congé individuel de formation ou d’un congé de reclassement dans les conditions des articles L. 28-27 et suivants.
L. 26-8.
Le licenciement réalisé en violation des dispositions précédentes est sanctionné par une indemnité calculée en fonction du préjudice subi qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
b) Décision de licencier
L. 26-9.
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
L. 26-10.
La lettre de licenciement précise les motifs du licenciement et les raisons qui ont conduit à l’échec des mesures alternatives à celui-ci.
Les motifs doivent être choisis parmi ceux évoqués dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement sont les seuls à pouvoir être invoqués en justice par l’employeur, comme justification au licenciement.
c) Préavis
L. 26-11.
Sauf en cas de licenciement pour faute grave commise par le salarié, la rupture du contrat de travail n’a lieu qu’à l’issue d’une période de préavis, décomptée à partir de la réception par le salarié de sa lettre de licenciement.
Cette durée est au minimum d’une semaine, si le salarié a au moins un mois d’ancienneté.
Elle est au minimum d’un mois, si le salarié a au moins six mois d’ancienneté
Elle est au minimum de deux mois, si le salarié a au moins deux ans d’ancienneté.
L. 26-12.
L’employeur peut dispenser le salarié d’exécuter son préavis, totalement ou partiellement.
Dans ces deux cas, l’employeur doit verser au salarié l’intégralité des sommes qui lui auraient été dues s’il avait intégralement exécuté son travail pendant le préavis, y compris l’indemnité de congés payés y afférente.
§ 2 : Justification
a) Préalables à la justification
L. 26-13.
L’employeur est tenu d’offrir au salarié des possibilités effectives de formation et d’adaptation aux évolutions prévisibles de son emploi.
À défaut, le licenciement pour motif économique ou pour insuffisance professionnelle du salarié est privé de cause réelle et sérieuse.
b) Cause réelle et sérieuse
L. 26-14.
À peine de nullité, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L. 26-15.
Le licenciement a une cause réelle lorsque la cause est objective, établie et exacte.
L. 26-16.
Le licenciement peut avoir une cause économique ou une cause personnelle.
L. 26-17.
Un licenciement pour motif économique est un licenciement dont la cause première n’est pas inhérente à la personne du salarié.
L. 26-18.
Une cause économique est sérieuse lorsqu’elle résulte d’une transformation ou d’une suppression d’emploi imposée :
– par des difficultés économiques sérieuses ;
– par une anticipation raisonnable de difficultés économiques à venir qui causeraient des licenciements ultérieurs plus importants ;
– par des mutations technologiques conduisant à la disparition d’emplois ;
– par la cessation d’activité de la personne physique qui emploie les salariés, ou qui exerce une influence dominante sur la personne morale qui emploie les salariés.
L. 26-19.
Un licenciement pour motif personnel est un licenciement dont la cause première est inhérente à la personne du salarié.
L. 26-20.
Seules peuvent être des causes sérieuses de licenciement pour motif personnel :
– une faute d’une importance telle que la sanction du licenciement est proportionnée à la faute commise ;
– une insuffisance professionnelle évaluée au vu des obligations contractuelles du salarié, des moyens mis à sa disposition et des obligations d’adaptation et de formation de l’employeur ;
– une impossibilité de maintenir l’emploi du salarié après avoir effectué toutes les mesures d’adaptation de son poste de travail et, le cas échéant, tenté de le reclasser à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail ;
– un trouble objectif et important dans le fonctionnement de l’entreprise.
L. 26-21.
Pour les salariés d’au moins soixante-dix ans, le bénéfice d’un droit à la retraite à taux plein est une cause réelle et sérieuse de licenciement.
c) Sanction
L. 26-22.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est nul.
L. 26-23.
Le salarié dont le licenciement est nul a droit à la réintégration dans son emploi et au paiement des salaires dus pour toute la période où l’employeur ne lui a pas fourni de travail.
L. 26-24.
Lorsque le salarié a perçu durant la période couverte par la nullité des allocations chômage pour privation d’emploi, il en fait état.
L’employeur rembourse le montant de ces allocations aux organismes qui les lui ont versées.
Ces sommes versées par l’employeur en remboursement des allocations reçues par le salarié sont déduites des salaires dus aux salariés pour la période couverte par la nullité.
Les droits du salarié à indemnisation ultérieure sont reconstitués.
L. 26-25.
Lorsque le salarié refuse sa réintégration, il a droit, en plus du paiement de ses salaires conformément aux articles précédents, à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 26-12, ainsi qu’au doublement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 26-30.
Le salarié qui prouve avoir subi un préjudice supérieur à celui couvert par les sommes précédemment mentionnées a droit, en outre, à une indemnité compensant ce préjudice.
L. 26-26.
Si le salarié n’a pas agi en justice dans l’année qui suit son licenciement, sans empêchement légitime d’agir, les rappels de salaires qui lui sont dus en vertu des articles L. 26-23 à L. 26-25 sont limités à un an.
L. 26-27.
Dans les entreprises de moins de dix salariés, lorsque les circonstances le justifient, le juge peut réduire l’indemnisation due au salarié, sans descendre en-deçà d’une indemnité pour licenciement injustifié égale à six mois de salaire.
L. 26-28.
Dans les entreprises d’au moins dix salariés, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnisation du salarié ne peut être inférieure à un an de salaire, rappels de salaires, indemnités compensatrices de préavis et indemnités de licenciement incluses.
L. 26-29.
Lorsque le licenciement a eu lieu en violation d’un droit fondamental du salarié, lorsqu’il constitue une discrimination prohibée, lorsqu’il vise un salarié victime de harcèlement, ou lorsqu’il a été décidé en violation des règles protectrices des salariés exposés prévues au chapitre L. 39-1 et suivants, une indemnité supplémentaire est accordée au salarié pour le préjudice que cette violation lui a fait subir, en plus des indemnités et rappels de salaire prévus aux articles L. 26-23 à L. 26-28 et L. 26-30.
Cette indemnité supplémentaire ne peut être inférieure au triple de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 26-30, ni à six mois de salaire.
§ 3 : Effets du licenciement
a) Indemnités de licenciement
L. 26-30.
Sauf faut grave commise par le salarié, une indemnité de licenciement égale à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté est due au salarié licencié.
La rémunération mensuelle prise en compte est calculée sur la base des douze derniers mois de salaire brut, tous éléments de salaire inclus.
L. 26-31.
Lorsque le licenciement a été prononcé pour faute grave et que l’existence ou la gravité de la faute n’est pas prouvée, les indemnités de licenciement dues au salarié sont doublées.
b) Transaction
L. 26-32.
Une transaction peut être conclue par les parties au contrat de travail, après l’expiration du préavis de rupture du contrat de travail.
L. 26-33.
La transaction comprend l’inventaire dressé par l’employeur des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
L. 26-34.
À peine de nullité, la transaction accorde au salarié, en contrepartie de sa renonciation à agir en justice, une indemnisation effective supérieure aux sommes qui lui sont dues.
L. 26-35.
La transaction mentionne précisément les catégories de créances pour lesquelles l’employeur et le salarié renoncent à agir en justice.
L. 26-36.
La transaction peut être dénoncée par le salarié dans les trois mois suivant sa signature.
A l’échéance du délai de dénonciation, la transaction régulièrement formée rend irrecevable toute action relative à l’une des prétentions qui relève de son objet.
L. 26-37.
Une transaction conclue en violation des articles précédents ou dénoncée dans les trois mois de sa signature n’a pas d’autre effet que celui d’attester de la nature et du montant des sommes qui ont été effectivement versées au salarié.