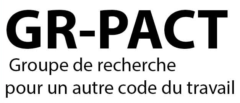§ 1 : Proclamation
L. 13-1.
Les droits fondamentaux des travailleurs sont notamment ceux visés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 ; la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail ratifiées par la France ; les Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques.
L. 13-2.
En vertu de ces textes, tout travailleur est notamment titulaire :
– du droit de grève ;
– de la liberté syndicale ;
– du droit à la négociation collective ;
– du droit de participer, par l’intermédiaire de délégués, à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises ;
– du droit à l’emploi et à un travail décent ;
– du droit à la santé et à la sécurité dans son travail ;
– du droit à une rémunération équitable assurant un niveau de vie satisfaisant ;
– du droit à la formation tout au long de la vie ;
– du droit à une protection contre le licenciement injustifié ;
– du droit au respect de sa vie personnelle, familiale, sociale, politique, citoyenne, philosophique et religieuse, y compris au temps et lieu du travail ;
– de la liberté de conscience ;
– du droit au repos, aux loisirs et au temps libre ;
– de la liberté d’expression, pendant comme en dehors de son temps de travail ;
– du droit au secret de ses correspondances ;
– du droit à un procès équitable ;
– du droit à l’égalité de traitement.
L. 13-3.
Nul ne peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des travailleurs. Tout acte qui produit une telle atteinte est nul.
Est une atteinte aux droits fondamentaux toute restriction faite à l’un de ces droits qui ne serait pas nécessaire à l’accomplissement de la tâche, ni proportionnée au but recherché.
§ 2 : Droit de grève
L. 13-4.
La grève est le droit de désobéir collectivement aux demandes et commandements de l’employeur, pour appuyer des revendications professionnelles.
L. 13-5.
Seule la loi peut encadrer l’exercice du droit de grève.
L. 13-6.
La retenue sur salaire que peut opérer l’employeur est, au maximum, proportionnelle à la durée de la grève. Dans les entreprises assumant la gestion d’un service public, l’exercice du droit de grève par le personnel directement affecté à cette activité doit être précédé d’un préavis.
L. 13-7.
Ce préavis est déposé par une organisation syndicale représentative au sens des articles L. 32-23 et suivants du présent code.
Il doit parvenir à la direction de l’entreprise au moins deux jours ouvrables avant le déclenchement de la grève.
La direction de l’entreprise qui reçoit ce préavis est tenue d’informer les usagers de l’éventualité d’une interruption de service.
Les salariés qui, de manière intentionnelle, exercent leur droit de grève sans respecter ce délai de préavis peuvent être sanctionnés d’une mise à pied qui ne saurait excéder deux jours.
L. 13-8.
Afin de permettre la continuité des services publics dont l’interruption aurait des conséquences sur la sécurité des personnes, un service minimum peut être mis en place à l’égard du personnel affecté à cette activité.
L. 13-9.
L’entreprise élabore, après consultation du comité de santé et des conditions de travail et du comité du personnel, un document précisant les effectifs nécessaires en vue d’assurer la continuité du service et les modalités de désignation du personnel affecté aux emplois indispensables pour assurer le service minimum.
L. 13-10.
Le service minimum doit être limité à l’exécution des tâches nécessaires à la préservation de la sécurité des personnes.
§ 3 : Égalité et non-discrimination
a) Principes
L. 13-11.
Les travailleurs ont droit à l’égalité de traitement, sans autres distinctions que celles justifiées par leur travail et leurs qualités professionnelles.
L. 13-12.
Toute mesure adoptée en raison d’un attribut de la personne humaine ou en raison de sa situation sociale est une discrimination prohibée.
En particulier, sont prohibées les différenciations selon les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, selon le genre, l’âge, l’état de santé ou le handicap, l’apparence physique, la naissance, l’origine, le domicile, la fortune, la situation de famille, le nom de famille, la langue natale.
L. 13-13.
Toute mesure adoptée en raison de l’exercice par un travailleur de l’un de ses droits fondamentaux est une discrimination prohibée.
En particulier, sont prohibées les différenciations selon les opinions, actions et pratiques religieuse, philosophique, politique ou syndicale, la participation à une grève, les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle.
L. 13-14.
Toute mesure défavorable en raison d’une activité citoyenne, comme celle d’élu, de juré, de témoin ou de lanceur d’alerte constitue une discrimination.
L. 13-15.
Toute mesure qui tend à produire des effets différenciés selon l’appartenance ou la non appartenance à une catégorie de personnes définie par l’un des critères mentionnés dans les articles précédents constitue une discrimination indirecte ou systémique.
Cette discrimination est prohibée, sauf si son auteur démontre que sa mesure est légitimée par un motif objectif, nécessaire, et indépendant de tout motif discriminatoire.
L. 13-16.
Le travailleur qui a des besoins propres et spécifiques doit bénéficier d’une protection adaptée.
En particulier, l’employeur doit adapter l’emploi au handicap, à l’état de santé, à la grossesse ou à la parentalité du salarié.
L. 13-17.
Les articles précédents ne font pas obstacle à une différence de traitement, lorsque celle-ci est nécessaire à l’accomplissement d’exigences professionnelles objectives, essentielles et légitimes.
b) Applications et sanctions
L. 13-18.
Toute organisation syndicale représentative ou association qui a pour objet la lutte contre la discrimination peut agir en justice en défense d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs discriminés.
La ou les personnes discriminées ne doivent pas s’être opposées à l’action en justice, préalablement portée à leur connaissance.
L. 13-19.
Toute mesure discriminatoire est nulle.
Le travailleur discriminé obtient réparation de son entier préjudice.
Lorsqu’un travailleur a été privé d’un avantage de manière discriminatoire, il a droit rétroactivement au bénéfice de cet avantage sur toute la période pendant laquelle il en a été privé.
L. 13-20.
En cas de discrimination au sens des articles L. 13-13 à L. 13-16, le juge peut ordonner un plan temporaire d’action positive en faveur d’un groupe discriminé au sein de l’entreprise.
Le juge en détermine les termes et en assure le suivi périodique.
Toute violation du plan constitue une nouvelle discrimination.
§ 4 : Prohibition des harcèlements
L. 13-21.
Aucun salarié ne doit subir de harcèlement moral.
Le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L. 13-22.
Aucun salarié ne doit subir de harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel est constitué :
– par des propos ou comportements à connotation sexuelle, dégradants, humiliants ou qui créent une situation intimidante, hostile ou offensante.
– par toute forme de pression grave exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L. 13-23.
Toute différence de traitement, directe ou indirecte, d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement ou pour avoir témoigné ou relaté de bonne foi d’un harcèlement, est nulle.
L. 13-24.
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel, y mettre un terme et les sanctionner.